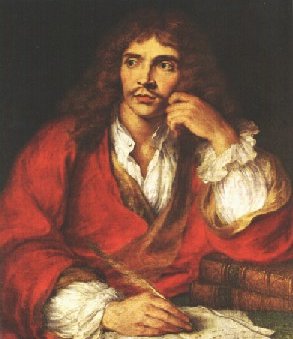
Molière soigne les médecins du XVII° siècle
S’il est un auteur qui s’est piqué de prodiguer ses « meilleurs soins » aux médecins et apothicaires, ainsi qu’aux diverses potions d’alors, c’est bien Molière.
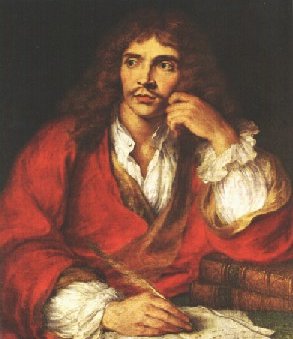
Jean-Baptiste Poquelin n’a pas manqué d’égratigner jusqu’au sang les savants de son époque et leurs remèdes censés être la panacée pour venir à bout de quelconque maladie qui se manifesterait.
Les titres de ces oeuvres sont bien connus et nettement évocateurs du mépris qu’il éprouvait face au monde scientifique : Le malade imaginaire, Le médecin malgré lui...
Mais bien avant ces « best-sellers », déjà Jean-Baptiste Poquelin avait pris les docteurs en grippe. Une allergie qui allait lui ouvrir les portes de la cour royale. Le 24 octobre 1658, au Louvre, dans la salle des gardes, Louis XIV s’est ennuyé lors de la représentation d’une des tragédies de Corneille, « Nicodème ». « Le Docteur amoureux », une farce créée par Molière divertit le roi.
On ne saura jamais pourquoi Jean-Baptiste Poquelin a choisi le pseudonyme de Molière. Selon l’une des versions, la plus « scientifique », il rappellerait l’étiquette d’un vin le « Molières » dont il aurait usé pour lutter contre son dégoût des eaux qu’il lui étaient nécessaires pour soigner une affection particulière.
Cette aversion pour les médecins et la pharmacopée en général peut s‘expliquer par les nombreuses consultations qu’il a du effectuer auprès des membres de cette profession. En 1665, à la fin de l’été, il est sujet à l’une de ses nombreuses crises de bronchite, mais se doit d’honorer la commande de Louis XIV pour une comédie-ballet.
Inlassablement il poursuit son travail, négligeant les médecins et leurs médecines bien que ceux-ci ne cessent d’harceler son esprit et de « doper » son imagination créatrice. Le 14 novembre, c’est la première du divertissement commandé par le monarque. « L’Amour médecin » est un réel règlement de comptes (d’apothicaire) avec la profession. Il y épingle tour à tour leur impuissance à guérir, leur avidité de l’argent ou bien encore leur prétention derrière laquelle se cache une profonde ignorance. Le latin de cuisine employé à l’époque par ces docteurs était l’écran de fumée idéal pour masquer leur incompétence.
Quant à leur apparence, avec des houppelandes descendant jusqu’aux pieds, une large collerette autour des épaules, une grande barbe et derrière une longue perruque, elle était censée inspirer le respect. Peut-être était-ce vrai pour le commun des mortels mais non pour le pamphlétaire qu’était Jean-Baptiste Poquelin. Il s’agissait d’une préciosité ridicule.
Son mal lui dicte ses mots
Le 27 décembre 1665, Molière a une crise violente d’hémoptysie. Il doit cesser ses activités jusqu’à la fin de l’hiver. En 1667, le 29 mars, une nouvelle crise le paralyse jusqu’à la fin de mai. Fin août, une rechute l’empêche de travailler jusqu’au 25 septembre. Dès lors, il devra lutter sans cesse contre la toux et la fièvre.
Durant cette période, naissent ainsi sous sa plume en 1665, l’Amour médecin, l’année suivante, le Médecin malgré lui. En 1669, c‘est au tour de Monsieur de Pourceaugnac, et la célèbre scène de la consultation.
Enfin, c’est le Malade imaginaire, dont il finira, agonisant, la quatrième représentation, le 17 février 1673.

Dans l’Amour médecin, il inocule son venin en s’attaquant directement aux docteurs de la Cour. Crise de jaunisse assurée pour les docteurs Fougerais, Esprit, Guénaut et Yvelin, en se retrouvant sous les pseudonymes des Fonandes, Bahis, Macroton et Fillerin.
Il écrit ce qu’il voit, et surtout ce qu’il vit. Plus son mal progresse, plus il devient créatif, virulent envers les docteurs et leur inefficacité à le guérir.
Dans le Médecin malgré lui, Sganarelle est contraint de se faire passer pour un docteur. L’occasion de se moquer de la charlatanerie des médecins et de la naïveté de leurs patients.
La consultation dans Monsieur de Pourceaugnac fustige tout le verbiage, les mots alambiqués ou en latin qu’utilisent les médecins pour se faire passer savants et masquer en fait leur ignorance.
Quant au Malade imaginaire, cette comédie fait apparaître les médecins comme étant eux-mêmes une maladie incurable qui ronge la société.
Monsieur Purgon le médecin d’Argan n’hésite pas à menacer son patient « de tomber dans la bradypepsie, de la bradypepsie dans la dyspepsie, de la dyspepsie dans l’asepsie, de l’asepsie dans la lienterie, de la lienterie dans la dysenterie, de la dysenterie dans l’hydropisie, de l’hydropisie dans la privation de la vie. ». Beau programme pour l’hypocondriaque qu’est Argan.
Argan interprété par Molière, compte l’argent que lui coûtent les médecins, chirurgiens-barbiers et apothicaires pour clystères et saignées. Son idée : marier sa fille à un docteur pour ainsi « avoir dans la famille la source des remèdes nécessaires, sans avoir à débourser un liard pour les consultations et les médecines ».
Molière fait la satyre des pratiques de son temps. Dans le ballet final, lors d’une cérémonie burlesque, il fait dire à Bachelierus le « credo » du parfait médecin :
« Clysterium donare,
Postea seignare,
Ensuitta purgare,.
Reseignare, repurgare et reclysteriare. »

Mauvillain, un ami avant d’être un médecin
Seul un médecin avait les faveurs de Molière. Il s’agissait du docteur Mauvillain, doyen de la Faculté. Ses « médicaments » pour réussir à guérir Jean-Baptiste Poquelin : son sens de l’esprit et sa capacité à reconnaître avec honnêteté les limites de la médecine.
Cet anti-conformiste avait séduit le pourfendeur des médecins.
La petite histoire veut que le jour où il le présenta à Louis XIV, ce dernier le questionna : « Voila donc votre médecin. Que vous fait-il? ». Ce à quoi Molière répondit « Sire, nous raisonnons ensemble; il m’ordonne des remèdes; je ne les fais point et je guéris ».
En 1644, Mauvillain s’inscrit à la Faculté de Médecine de Paris et décroche deux ans plus tard son titre de bachelier après avoir soutenu une thèse sur l’utilité des eaux de Forges dans le traitement des convalescences difficiles. En 1648, il décroche sa licence, mais à la dernière des six places à pourvoir. Et ce malgré la recommandation d’un ami de sa famille, Michel de Masles, abbé des Roches. Celui-ci pensait en effet pouvoir compter sur le soutien de la Faculté, en contrepartie d’un don de 30000 Livres effectué trois ans auparavant pour la création de nouveaux locaux.
Son mauvais classement retarde de deux ans son admission aux épreuves du doctorat et l’empêche de rejoindre ainsi la centaine de personnalités qui président aux destinées de la Faculté, tous coiffés du bonnet carré, symbole de leur pouvoir. Jean-Armand de Mauvillain ne tarde pas à mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ce, dès la cérémonie au cours de laquelle il lui a été rappelé les obligations de sa fonction sous peine de nullité, de privation du fameux bonnet et de l’interdiction d’être admis à tout jamais au doctorat.
Mauvillain « saute sur l’occasion » et monte en chaire. Loin de procéder au traditionnel discours en l’honneur de ses maîtres, il n’adresse ses remerciements qu’à l’abbé des Roches, lui demandant « d’accorder un généreux pardon aux docteurs qui avaient payé ses bienfaits de la plus noire ingratitude ».
Trois fois le doyen lui demande de retirer ses propos. Par trois fois, il refuse.
La Faculté se donne trois jours pour délibérer et lui « propose » d’aller présenter ses excuses au domicile de chacun de ses nouveaux confrères et de faire de même en public auprès du doyen lorsqu’il présidera sa première thèse. Il cède. Mais bientôt, il se fait remarquer en donnant avec onze autres médecins la caution de la Faculté à un charlatan vendant « l’Orviétan » capable de guérir en 24 heures toutes les maladies. Jean Piètre, le doyen de l’époque fort courrouçé leur demande de se rétracter. Ce que fait de bonne grâce Mauvillain qui durant une dizaine d’années « rentre dans le rang ». Mais le calme est de celui qui précède les tempêtes. Le détonateur sera l’ opposition entre les pro et les anti-antimoine. Jean-Armand de Mauvillain fait partie des premiers. Or l’un des chefs de file de l’autre camp, Blondel, est nommé doyen. Pour le contestataire qu’est Mauvillain, cette élection est inadmissible.En 1658, il préside une thèse en remplacement d’un collègue et demande les émoluments correspondants.
Blondel refuse et Mauvillain s’emporte, traitant le doyen d’avare, d’homme de mauvaise foi. Le pugilat menace mais avant de partir, Mauvillain arrache le bonnet de Blondel, le piétine et s’en va avec.
Peu de temps après, avec deux de ses collègues qui l’avaient soutenu, c’est le passage devant le Conseil de la Faculté. Verdict : quatre ans d’exclusion.
C’est la victime de l’intransigeance et de l’autoritarisme de la corporation médicale. Sa verve, son humour décapant, son goût prononcé pour les festivités bien arrosées le font fréquenter les salons où se réunissent les artistes, les gens de Théâtre.
Mauvillain et Molière y ont fait connaissance. Les idées les rapprochent. L’un entend régler ses comptes avec ses confrères médecins, ironisant sur leur ignorance et leur prétention, leur frénésie à prescrire clystères, saignées, séné, tisanes de son... L’autre aime l’insolence et l’indépendance, et puise dans les anecdotes les plus savoureuses de Mauvillain ce qu’il mettra plus tard en scène.
Puis Jean-Armand Mauvillain devient à son tour doyen et succombe aux effets du pouvoir. Il n’est plus le rebelle, celui qui empêchait la Faculté de Médecine de tourner rond. De son côté, Molière, lui, ne change pas.
« Sans l’ignorant docteur qui fut l’assassin de Louis, nos maux n’auraient jamais pris fin » est le refrain qu’entonne le peuple lorsque s’achève le règne de Louis XIV. C’est dire l’estime dans laquelle le peuple tient le corps médical de l’époque. Ce qui est bien dans l’esprit de Poquelin, pourtant il n’aurait sûrement pas été d’accord . Molière entretenait en effet avec le Roi Soleil des relations privilégiées. Le monarque n’a-t-il pas été le parrain de son fils aîné?
Quoiqu’il en soit, les comédies de Molière avaient atteint leur objectif : celui de dénoncer les faux savants et les prétentieux.
Constipation : faire sauter le bouchon
De tout temps, la constipation a donné naissance à un nombre impressionnant de médicaments et de traitements de toutes sortes.
Déjà la médecine de l’Egypte ancienne s’est intéressée aux affections concernant les voies digestives, mais les papyrus médicaux sont relativement rares. L’un des plus complets et également le premier connu est le papyrus Ebers qui est un traité de pathologie médicale et de pharmacologie.
Il comporte tout un chapitre consacré à la constipation et recèle pas moins de douze recettes purgatives destinées à « libérer le ventre ».
Dans toutes ces compositions pharmaceutiques figurent de la bière, du miel ou de l’huile ainsi que des graines de ricin.
« Autre remède pour libérer le ventre et faire disparaître la maladie dans le ventre d’un individu : graines de ricin. A mâcher et à avaler avec de la bière, jusqu’à ce que tout ce qui est dans son ventre en sorte ».
Le papyrus Ebers propose aussi d’autres purgatifs : « ...Tu prépareras un remède pour expulser, en les lavant, les aliments cuits qu’il a absorbés et pour ouvrir son intestin au moyen d’une potion « bière douce ». A laisser exposé la nuit avec des fruits entaillés, du sycomore séché, et sera mangé et bu pendant quatre jours. Dès le matin... chaque jour, tu examineras ce qui est descendu de son derrière ».
Pour lutter contre la constipation, les Egyptiens avaient également recours à d’autres ingrédients tels que du gengenet, des graines du souchet comestible, appelées également cheveux de terre, des graines de pin-pignon.
En Grèce Hippocrate préconisait, déjà à l’époque les lavements ou divers purgatifs.
Les pilules perpétuelles
Plusieurs siècles plus tard les pilules perpétuelles qui provoquaient une purgation mécanique et chimique font leur apparition et rencontrent un vif succès. Il s’agissait de pilules métalliques avec de l’antimoine, du tartre blanc et du salpêtre. Elles étaient, soient louées chez les apothicaires, puis récupérées dans les selles et ramenées à l’officine, soient achetées pour les transmettre à leurs descendants...
Cet antimoine prôné par les Alchimistes soulevait bien des polémiques entre les « anti- et pro-antimoine ». Les détracteurs résumaient son activité en trois mots : « vomere, sudare, cacare », tout un programme de circonstance contre la constipation.
En dehors de cette utilisation, l’antimoine sera utilisé sous d’autres formes dans divers états pathologiques plus particulièrement au XVII° siècle.
Plus « énergique » encore, était l’utilisation du mercure au XV° siècle et ce jusqu’au XIX°. L’idée était d’utiliser son poids pour faire pression sur l’étranglement intestinal. Le malade devait avaler une livre de mercure. Il était ensuite mis dans un bain, secoué par deux « infirmiers » pour bien faire descendre le mercure dans l’intestin.
Le XVII° siècle est, lui, celui des laxatifs chimiques. Les découvertes se succèdent.
En 1608, Béguin découvre le calomel, ou chlorure mercureux. En 1616, Wieker réalise la synthèse du sulfate de magnésie. En 1625 apparaît le sel de Glauber qui est en fait le sulfate de sodium. En 1662, naît le sel de Seignette, à base de tartrate double de sodium et de potassium.
L’eau-de-vie allemande, dosée entre 20 et 60 grammes dans une tasse de thé était réputée pour son efficacité. Sa composition était à base d’esprit-de-vin, dans lequel avaient infusé du turbith, de la scamonée, du jalap.
L’eau-de-vie allemande, baptisée, par ailleurs, eau de jalap n’entrera dans la pharmacopée française qu’au début du XIX° siècle.
Deux autres préparations, la tinctura catholica et la tinctura catharlica présentent des analogies... mais avec d’autres ingrédients : séné, ellébore noir, rhubarbe…
« Clysterium donare »
Selon la tradition, les médecins égyptiens auraient remarqué comment l’ibis se soulage des obstructions intestinales « en puisant de l’eau de mer avec son bec et en se la mettant au fondement pour luy ouvrir le ventre ». Le roi-médecin Thot, celui dont le nom s’écrit avec l’hiéroglyphe représentant l’ibis, aurait été le premier à proposer cette thérapeutique.
L’ère des lavements a connu son heure de gloire à partir du XVI° siècle, avec tout d’abord la bourse à clystère. Au siècle suivant, elle avait cédé la place à la seringue à clystère, dans son étui en cuir, porté en bandoulière par les aides-apothicaires. L’administration des clystères est le fait de l’apothicaire qui se rend au domicile des malades pour cette opération bien codifiée : « Le malade doit quitter tout voile importun : il s’inclinera sur le côté droit, fléchira la jambe en avant, et présentera tout ce qu’on lui demandera, sans honte ni fausse pudeur. De son côté, l’opérateur, habile tacticien, n’attaquera pas la place comme s’il voulait la prendre d’assaut ; mais comme un tirailleur adroit qui s’avance sans bruit, écarte ou abaisse les broussailles ou les herbes importunes, s’arrête, cherche des yeux, et qui, lorsqu’il a aperçu l’ennemi, ajuste et tire : ainsi l’opérateur usera d’adresse, de circonspection, et n’exécutera aucun mouvement avant d’avoir trouvé le point de mire. C’est alors que, posant révérencieusement un genou en terre, il amènera l’instrument de la main gauche, sans précipitation ni brusquerie, et que, de la main droite, il abaissera amoroso la pompe foulante, et poussera avec discrétion et sans saccades, pianissimo »
Avec la vogue du clystère, les apothicaires du siècle gagnent beaucoup d’écus. Aussi, un apothicaire lyonnais, enrichi par cette pratique, eut pour épitaphe :
« Ci-gît qui, pour un quart d’écu
s’agenouillait devant un cul. »
La seringue à clystère a subit au fil des ans certaines améliorations. Ainsi, pour faciliter les lavements et les généraliser, il a été adapté un tube intermédiaire flexible et imperméable qui permettait au malade de s’administrer lui-même le lavement. Le « clystère soi-même » ne fut pas une innovation du goût des apothicaires.
Le chlysoir précède la chlysopompe avec une petite pompe à jet continu. Mais l’innovation la plus particulière a été celle de l’irrigateur à ressort du docteur Eguisier qui présente de nombreux avantages : « d’une manoeuvre sûre, commode et facile, permettant d’administrer un remède en quantité déterminée et sans que les malades aient pour ainsi dire, à faire un seul mouvement ». Côté technique, cet irrigateur était un cylindre vertical, étant le corps de pompe, muni d’un ressort comme pour une pendule. A son extrémité inférieure se trouvait un embout où était branché le tuyau en caoutchouc. Le malade n’avait qu’à tourner le robinet pour que le liquide coule. Comble de raffinement, certains de ces irrigateurs étaient associés à des boîtes à musique qui délivraient les dernières valses à la mode.
Déjà le temps des portables
Une autre curiosité fait ensuite son apparition. Pour les voyageurs, les globe-trotters d’antan, mais constipés, « l’Enéma » propose la solution miracle. Le luxe du lavement : un bidet portatif, démontable, facilement transportable, « agrémenté » d’un irrigateur à poire de caoutchouc aspirante et foulante, au bout d’un tuyau flexible.
Si aujourd’hui on emploie le goutte à goutte rectal, l’abondance était de mise à une certaine époque.
Un nettoyage du colon pouvait nécessiter entre 20 et 30 litres d’eau et réclamer l’utilisation de sondes rectales variant de 30 à 60 centimètres de longueur.
Outre le matériel utilisé, la diversité des produits a été, elle aussi, extrêmement large. Qu’y avait-il dans les lavements? De l’huile d’olive « assaisonnée » de jaune d’œuf, de glycérine, d’eau savonneuse, d’alcool de camphre...
Certains lavements se faisaient aussi par la bouche, par une alimentation bien choisie pour ses effets « libérateurs ».
Au menu; l’eau, les bouillons, le lait, les sels, l’alcool...
Le tabac fut également conseillé pour faciliter l’évacuation, que ce soit en fumée ou bien en décoction, de préférence le matin et avec des résultats probants.
Autre méthode mise en pratique pour libérer les constipés, l’eau de seltz, soit nature, soit à l’aide des sachets en poudre destinés à la fabriquer. Hippocrate avait déjà préconisé l’air pour « déboucher » l’intestin en l’insufflant à l’aide d’un soufflet de forgeron.
L’électrothérapie, apparue au XIX° siècle, a marqué une nouvelle étape dans l’assainissement des « conduits » intestinaux : une décharge électrique pour faire sauter le bouchon!
La technique étant d’introduire dans l’anus une électrode baptisée « excitateur rectal » qui, semble-t-il, faisait effet sur les douleurs rhumatismales et les colites.
Les massages ont également cours pour lutter contre la constipation.
Rotatoires, vibratoires, les massages étaient pour ceux qui les administraient et ceux qui les recevaient bien détaillés, afin d’éviter les mauvaises manipulations.
Quelques règles devaient être scrupuleusement respectées comme la précaution d’uriner avant le massage, bien déceler qu’il n’y ait pas de calculs...
Vient ensuite l’heure de la tisane, qui remonte pourtant aux époques les plus lointaines, par exemple à celle de l’Egypte ancienne, dont déjà le Séné et ses vertus « digestives » était recommandé.
Il faudra attendre le début du XIX°siècle et plus précisément 1802, pour que les principes actifs contenus dans les plantes soient extraits et puissent être réellement utilisés pour leurs propriétés curatives.
C’est en effet à cette date que Stertuerner parvient à extraire la morphine de l’opium.
Au fil des ans, les découvertes se succèdent. Quinine, digitaline, cocaïne... sont isolées des plantes qui les contiennent.
S’ensuivit alors la longue litanie des laxatifs végétaux, à base de Séné, d’agar-agar ou bien encore de pruneaux. Un fruit, qui de nos jours encore dans les esprits est associé à l’idée de délivrance des intestins.
Les liquides libérateurs
Pour lutter contre la constipation, la consommation de liquides a été de tous temps préconisée. De l’eau, bien évidemment, mais aussi du café au lait, de la bière, du cidre... et de l’eau de mer.
Un médicament efficace, mais difficile durant longtemps à se procurer loin des côtes. Deux principaux inconvénients se posaient à l’époque : son goût désagréable et sa conservation difficile, de très courte durée.
C’est grâce aux travaux d’un pharmacien de Fécamp, Monsieur Parquier que les solutions à ces problèmes ont pu être résolus.
Il alla puiser de l’eau loin des côtes et à une certaine profondeur, avant de procéder à son filtrage. Pour la question du goût, pour le masquer, il lui adjoint du gaz carbonique.
Il était nécessaire de soumettre ce procédé à une commission scientifique. Les tests furent concluants. Il n’y a pas eu d’altération de l’eau de mer et les patients constipés traités avec ce médicament naturel ont bénéficié d’un purgatif beaucoup plus efficace que les précédents.
L’hydrothérapie prenait à son tour sa place dans la lignée des médecines destinées à lutter contre la constipation. Des compresses d’eau froide appliquées sur l’abdomen étaient censées provoquer la diarrhée.
L’emploi des eaux thermales, connues depuis l’antiquité pour leurs vertus, allait connaître un nouvel essor sous la III° République.
Au hit-parade des stations les plus prisées figurent notamment Plombières, Chatelguyon, et Barbazan...
Mais actuellement, l’engouement des patients français pour les eaux thermales est moindre que dans les autres pays européens.
Pour les purgations qui sont une « fin en soi », laissons le mot de la fin à un éminent spécialiste en humour qui laissa ses études de pharmacie pour le journalisme.et se livra à l’auto-obsevation dans ce poème :
« Ayant pris le matin une purgation forte,
Le jeune Alphonse à chaque instant courait,
Se levait, s’asseyait, ouvrait, fermait les portes.
Alphonse allait ».
Alors, en selle...
Quelques laxatifs aux diverses propriétés
- Les purgatifs salins; Sulfate de sodium, de magnésie ou sel de Seignette et les sucres; la manne, issue de l’écorce de frêne, le miel, les pruneaux agissent par osmose et favorisent un appel de liquide.
- Les laxatifs, comme l’huile de paraffine ou de ricin, favorisent la lubrification de la muqueuse intestinale.
- La calomel, le sorbitol, le boldo, l’huile d’olive ou bien encore la bile de bœuf agissent sur la constipation en favorisant l’excrétion et la sécrétion de la bile.
- Les mucilages, extraits d’algues marines ou bien de certaines graines comme celles du lin font augmenter le bol alimentaire. Le séné, le cassia, la datte indienne... irritent la muqueuse. Dans les deux cas, c’est le péristaltisme intestinal qui se trouve stimulé.
J.L.D.